|
EN BREF
|
À l’heure où l’urgence climatique s’intensifie, les retombées économiques de l’engagement pour le climat prennent une place prépondérante dans les débats publics et politiques. Les transformations nécessaires pour atteindre la neutralité climatique s’accompagnent d’un impératif de réorientation des mécanismes économiques, reposant sur des technologies vertes, une sobriété énergétique et la substitution des énergies fossiles. En dépassant la simple dichotomie entre croissance et durabilité, il devient évident que des stratégies d’adaptation peuvent générer une croissance verte plus forte, ouvrant ainsi la voie à une prospérité économique innovante et responsable. Dans ce contexte, les choix effectués aujourd’hui sur les politiques climat et économiques façonneront les trajectoires de notre société dans les décennies à venir.

L’urgence d’une action climatique
La neutralité climatique est devenue un objectif atteignable, mais cela nécessite une transformation profonde de notre économie, comparable aux révolutions industrielles du passé. Contrairement à ces précédentes révolutions, cette transformation doit être rapide et dirigée par les politiques publiques plutôt que par les innovations technologiques. Pour réussir, il est essentiel d’adopter trois mécanismes économiques : orienter le progrès technique vers des technologies vertes, promouvant la sobriété énergétique, et substituer les énergies fossiles par d’autres formes de capital. Cette mutation ne signifie pas nécessairement choisir entre croissance et climat, car une croissance verte peut émerger, comme en témoigne la baisse des coûts des énergies renouvelables.
Pour atteindre nos objectifs climatiques de 2030 et 2050, nous devons agir avec la même rapidité que nous le souhaitons depuis des décennies. Les politiques doivent imposer des budgets carbone stricts au lieu de se contenter de cibles lointaines. Une partie de cette transformation dépendra de la transition vers une économie moins dépendante des combustibles fossiles, car la sobriété ne peut couvrir qu’une petite part de cette réduction. Ce chemin exigera des investissements significatifs, représentant plus de deux points de PIB en 2030. Cela implique non seulement un ralentissement temporaire de la productivité, mais aussi une réaffectation des ressources sur le marché du travail, ce qui peut engendrer des tensions économiques durables. Les indicateurs traditionnels, comme le PIB, ne permettent pas de saisir pleinement ces enjeux, car la transition peut également entraîner un coût en bien-être difficilement mesurable.
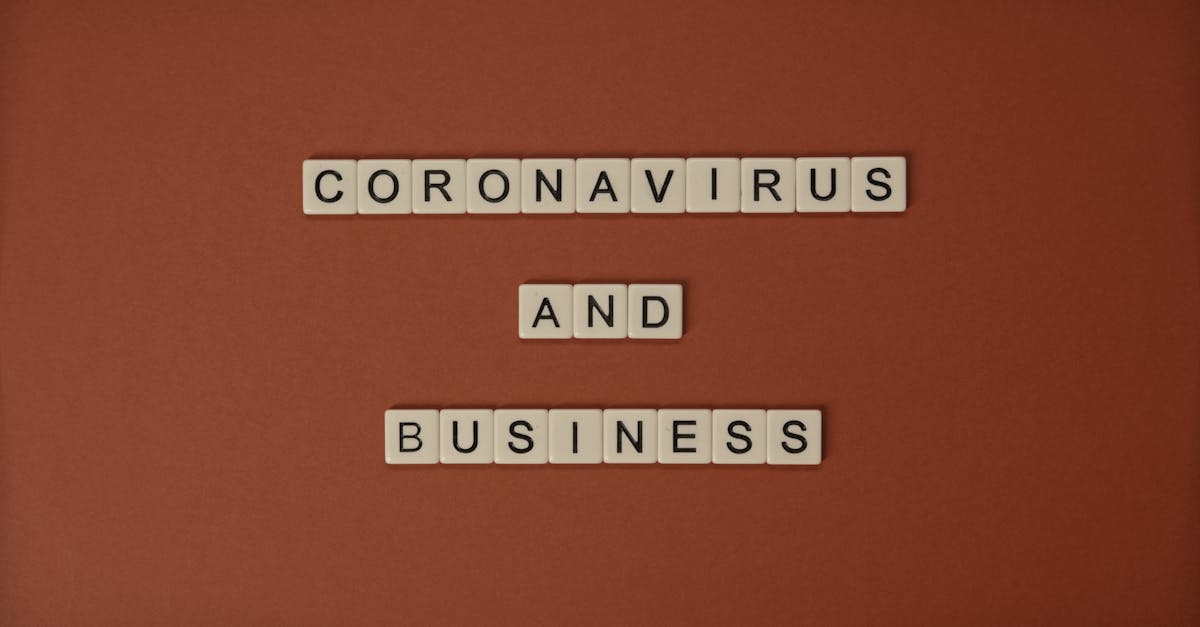
L’urgence d’une action climatique
La neutralité climatique est à portée de main pour notre société, mais son atteinte nécessitera une transformation d’une ampleur sans précédent, comparable aux révolutions industrielles passées. Cependant, cette mutation devra être d’une nature globale et se dérouler rapidement, avec un pilotage qui sera principalement assuré par les politiques publiques plutôt que par des innovations technologiques. Pour soutenir cette transformation, trois mécanismes économiques fondamentaux doivent être mis en exergue : la réorientation du progrès technique vers des technologies vertes, la sobriété énergétique (définie comme la réduction des consommations d’énergie qui ne découle pas de gains d’efficacité), et la substitution de capital aux énergies fossiles. Les données récentes révèlent que la chute des prix des énergies renouvelables témoigne d’une possibilité de croissance verte, potentiellement plus forte que la croissance traditionnelle basée sur des ressources fossiles.
Par ailleurs, en se projetant vers 2030, la transition nécessitera de réaliser en dix ans ce qui a pris trois décennies à être mis en place, engendrant un besoin d’accélération extrêmement brusque dans tous les secteurs d’activité. Une approche proactive, incluant l’instauration de budgets carbone au niveau de l’Union européenne et de la France, serait essentielle pour garantir le respect des engagements climatiques. Il est également crucial de noter que, alors que la sobriété contribuera à la réduction des émissions, elle ne devra pas être perçue comme synonyme de décroissance, mais plutôt comme une opportunité d’amélioration du bien-être, alliant efficacité et durabilité.

L’urgence d’une action climatique
La transformation nécessaire pour atteindre la neutralité climatique
La neutralité climatique est un objectif réalisable, mais elle requiert une transformation d’une ampleur comparable aux révolutions industrielles passées. Contrairement à celles-ci, cette transformation devra être plus rapide et guidée principalement par les politiques publiques, plutôt que par des innovations technologiques ou des forces du marché.
Les principes de cette transformation reposent sur trois mécanismes économiques clés :
- Réorientation du progrès technique vers des technologies vertes pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
- Sobriété, qui vise à réduire les consommations d’énergie non liées aux gains d’efficacité, pouvant contribuer à la fois à des économies pour les ménages et à la protection de l’environnement.
- Substitution de capital aux énergies fossiles, afin d’encourager des investissements vers des infrastructures durables.
Un bon exemple à suivre peut être trouvé dans la chute significative des coûts des énergies renouvelables, qui montre que nous pouvons diriger notre économie vers une croissance verte qui dépasse les performances de l’ancienne croissance dépendant des énergies fossiles.
La décennie de toutes les difficultés
Défis prévus et investissement nécessaire
Pour atteindre nos objectifs climatiques pour 2030 et viser la neutralité en 2050, il sera nécessaire de réaliser en dix ans des progrès qui ont pris trente ans dans le passé. Tous les secteurs de l’économie devront s’impliquer, ce qui demande un effort collectif immédiat.
Cette transition nécessitera un investissement massif ; nous estimons qu’il faudra plus de deux points de PIB d’ici 2030 pour financer les initiatives nécessaires. Ce montant devra être alloué à la decarbonation de notre économie.
- Anticiper une diminution des recettes fiscales liée à la transition, ce qui pourrait exiger des ajustements budgétaires.
- Prendre des mesures pour compenser le ralentissement de la productivité controversé, qui pourrait émerger pendant cette période d’investissement accru.
- Comprendre que la transition climatique engendrera sans doute des coûts économiques qui doivent être équitablement répartis pour éviter des tensions sociales.
Pour plus d’informations sur les indicateurs économiques de l’action climatique, consultez les rapports réalisés par différentes institutions, comme ceux publiés dans le cadre de la mission confiée à Jean Pisani-Ferry.
Les enjeux économiques de l’action climatique
La croissance durable est un défi majeur qui exige une transformation profonde de nos systèmes économiques. Pour atteindre la neutralité climatique, il est crucial de réunir une centaine d’experts issus des administrations et du monde de la recherche, afin d’explorer les implications de cette transition. Les travaux récents mettent en évidence que cette transformation doit être guidée par des politiques publiques plutôt que par des innovations technologiques.
Trois mécanismes économiques structurent cette transformation : la réorientation du progrès technique vers des technologies vertes, la sobriété énergétique, et la substitution des énergies fossiles par du capital. Ainsi, même si la transition peut sembler difficile, il est possible d’atteindre une croissance verte qui surpassera la croissance traditionnelle. La récente baisse des coûts des énergies renouvelables en est une preuve tangible.
À l’horizon 2030, il sera nécessaire d’accélérer les efforts de transformation, d’atteindre des objectifs ambitieux et d’imposer des budgets carbone, au-delà des simples cibles à long terme. Ce processus impliquera une hausse significative des investissements, du moins à court terme, couplée à des ajustements structurels sur le marché du travail.
La transition climatique pose aussi des défis en matière d’équité. Les investissements nécessaires peuvent représenter un fardeau financier, même pour les classes moyennes. Il est primordial que le coût de cette transition soit réparti de manière équitable pour assurer son acceptabilité sociale et politique. Pour aider les ménages, le soutien des finances publiques sera essentiel, bien qu’il soulève des préoccupations concernant l’endettement.
Alors que l’Union européenne s’efforce de rester compétitive à l’échelle mondiale, les actions climatiques doivent s’articuler avec une vision claire des implications économiques. Cela nécessite une gouvernance renforcée et une articulation efficace des politiques européennes et nationales.
Le rapport final sur les incidences économiques de l’action pour le climat présente donc une vision intégrée, synthétisant des analyses rigoureuses qui éclairent les décideurs sur l’urgence d’une action concertée et adaptée.

La mobilisation d’une centaine d’experts a permis d’approfondir les enjeux liés à l’action pour le climat dans le contexte de la préparation des prochaines lois de programmation énergétique et climatique. Les transitions nécessaires pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 exigent une transformation substantielle des dynamiques économiques. Cela implique des mécanismes tels que la réorientation vers les technologies vertes, la sobriété énergétique et la substitution des énergies fossiles.
Pour atteindre les objectifs fixés, un effort d’investissement considérable est requis, additionné au besoin d’un soutien financier fort des finances publiques. La transition vers une économie durable n’est pas seulement nécessaire, mais elle peut également offrir une croissance verte, bien plus soutenable que les modèles économiques polluants. Néanmoins, les projets doivent être équitablement répartis pour ne pas creuser les inégalités sociales.
Le défi réside désormais dans la capacité à garantir que ces transformations se fassent de manière équitable et effective, tout en maintenant une compétitivité au sein du marché mondial. Le chemin vers une économie décarbonée implique de concrétiser les promesses par des actions tangibles, tout en gardant un œil sur les conséquences économiques à long terme.




